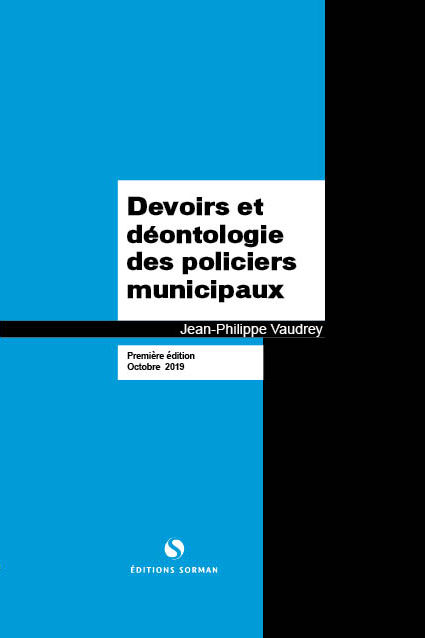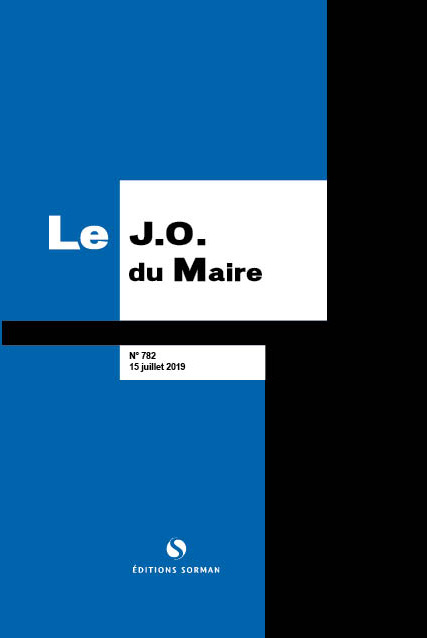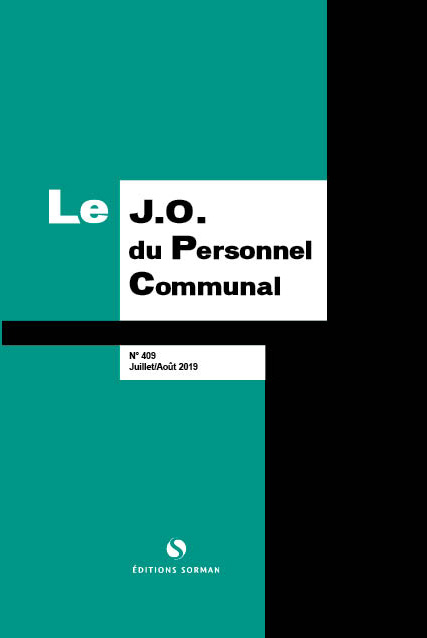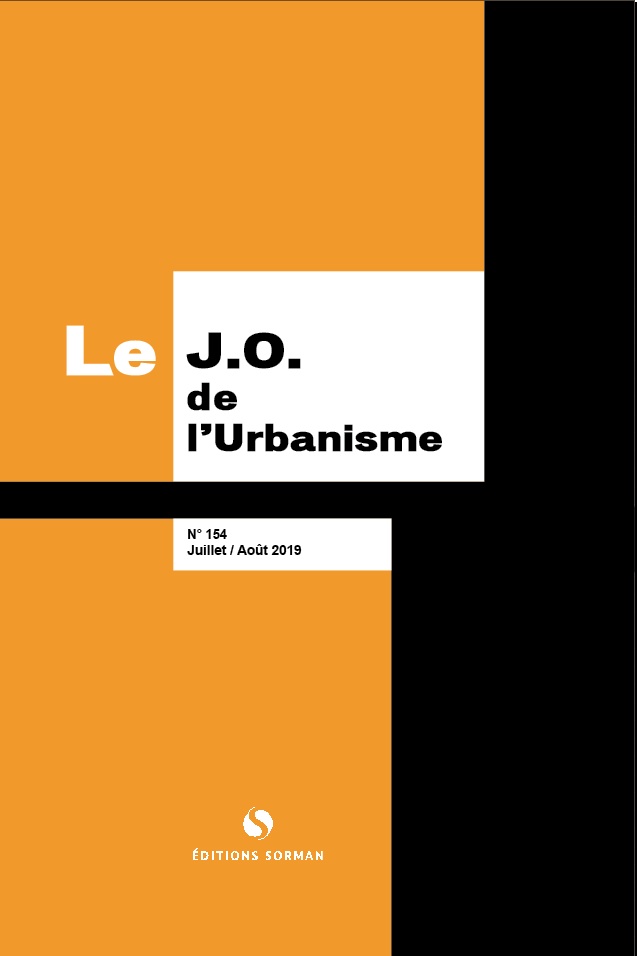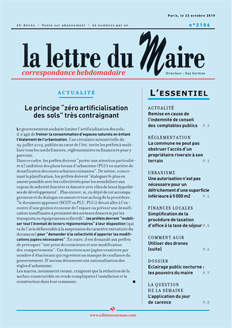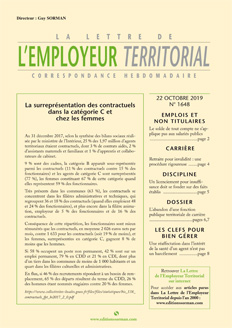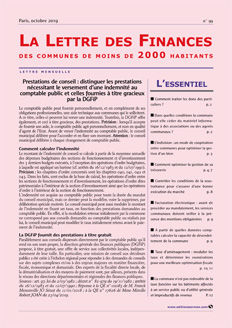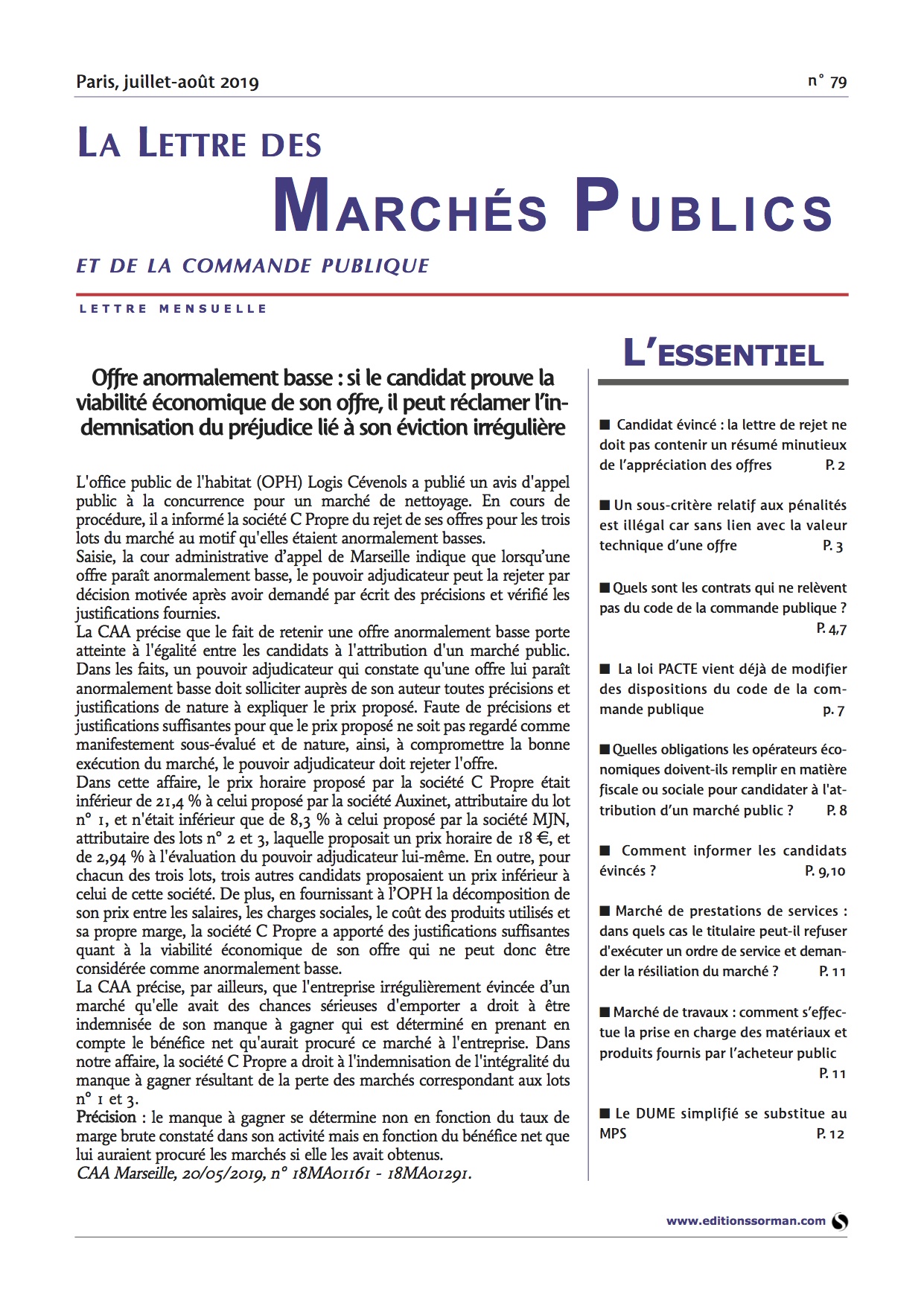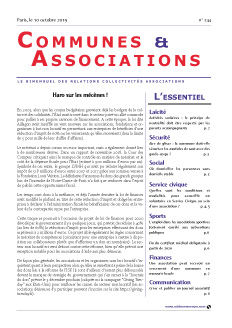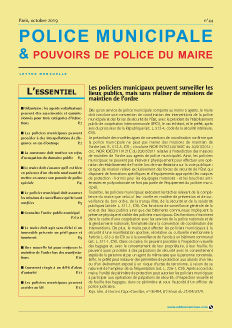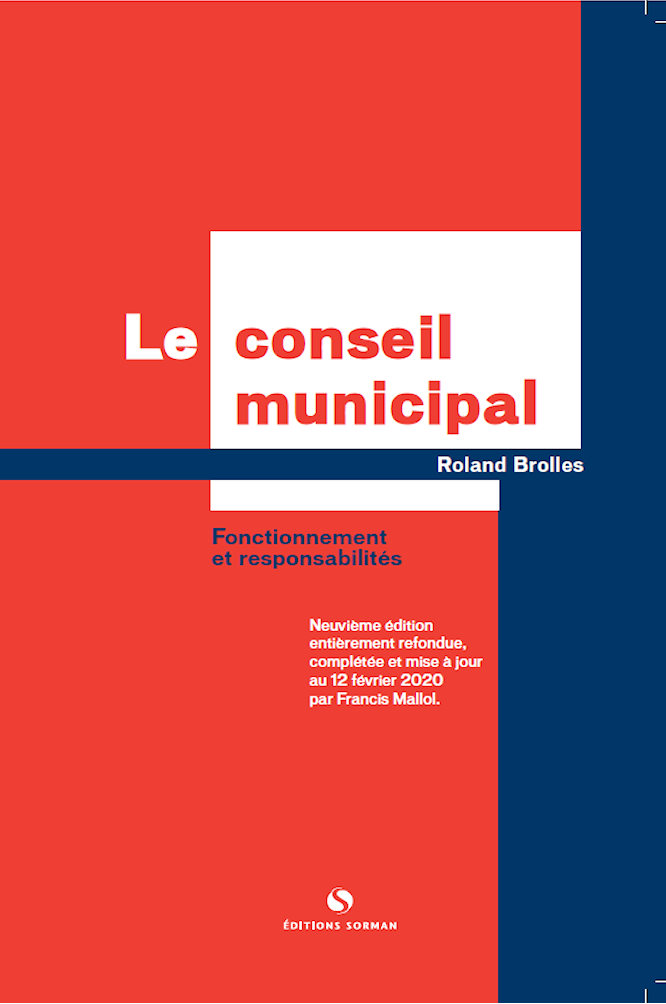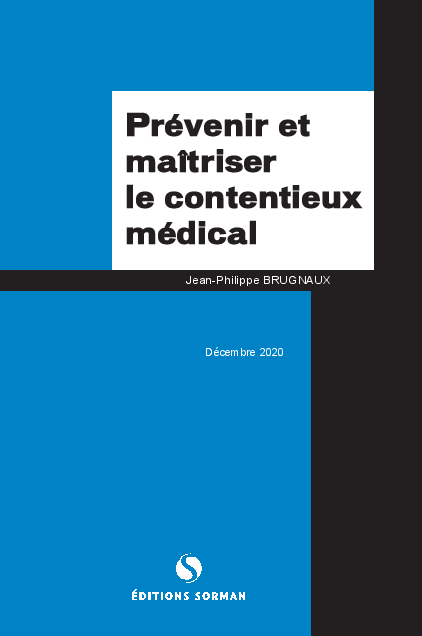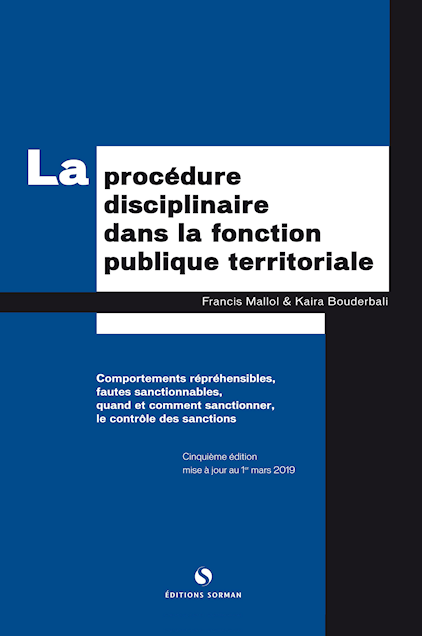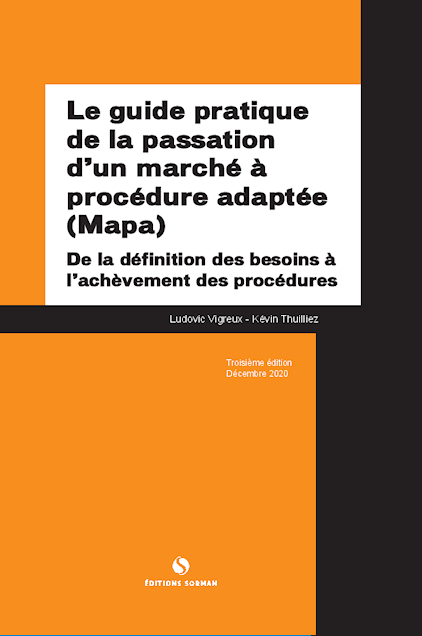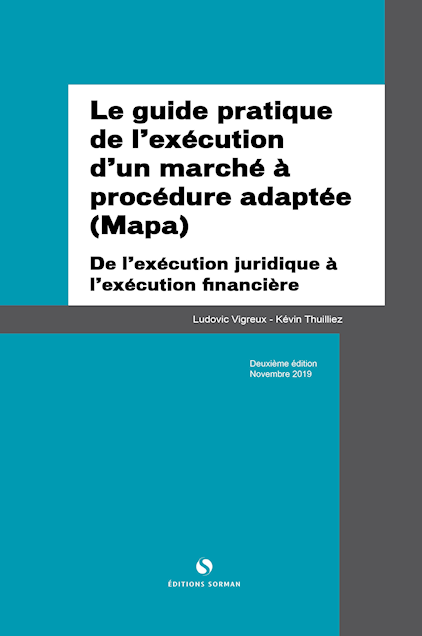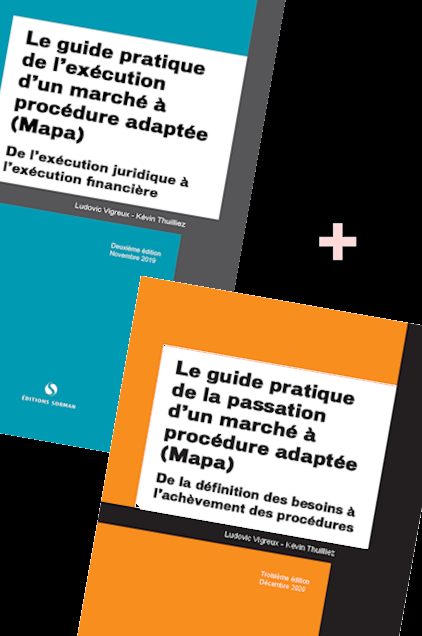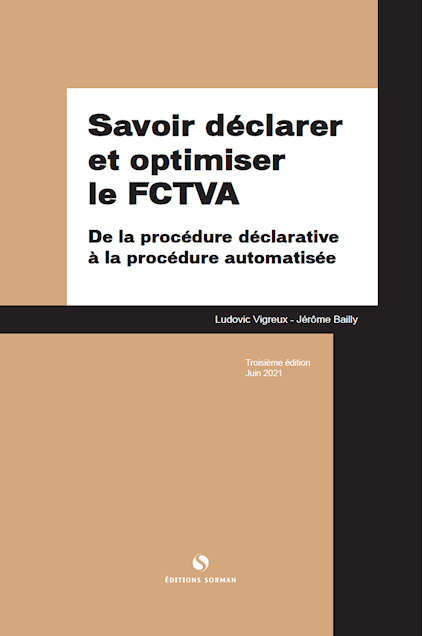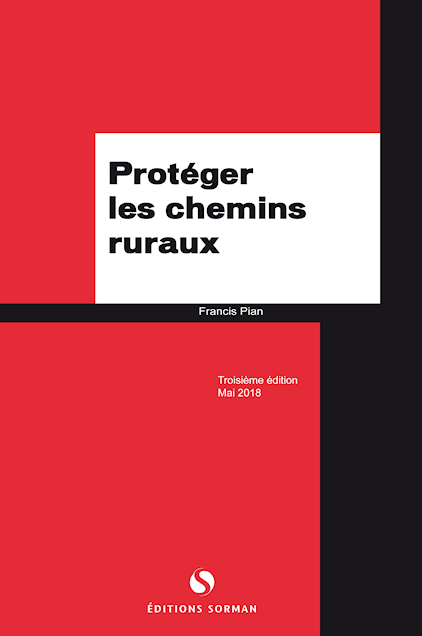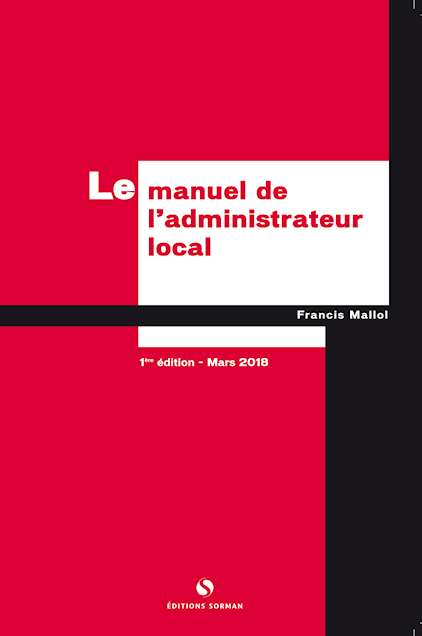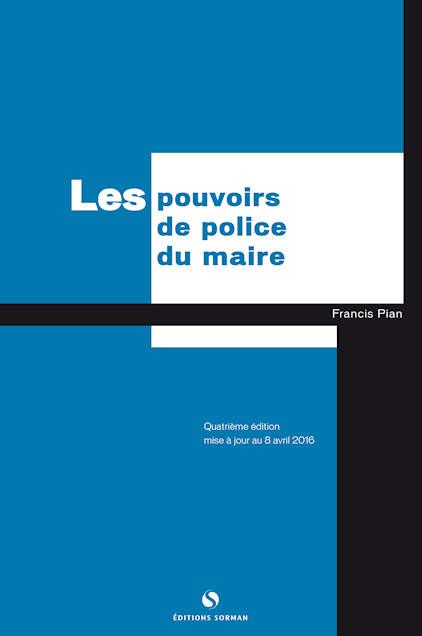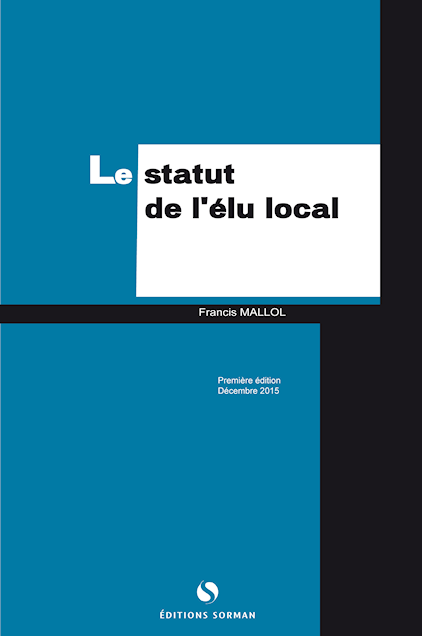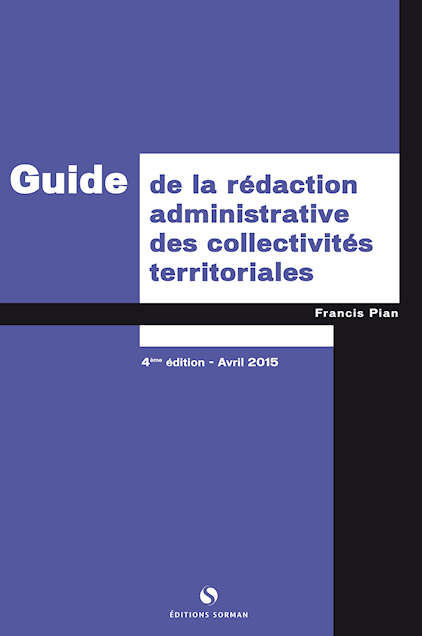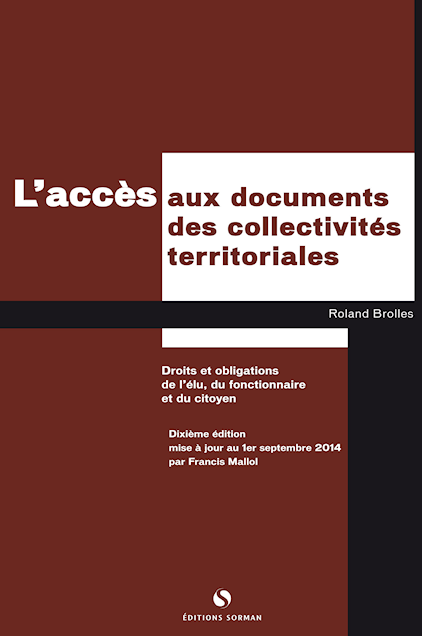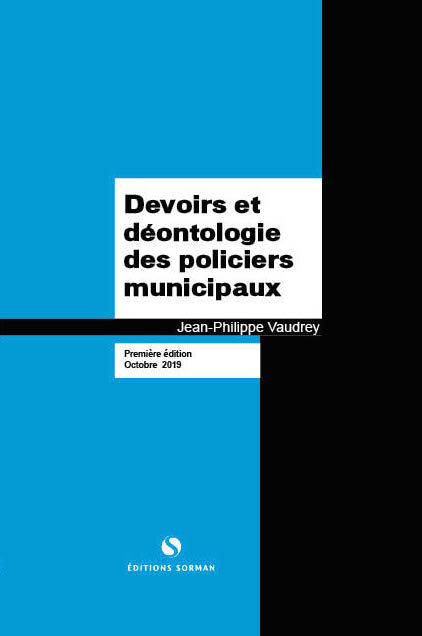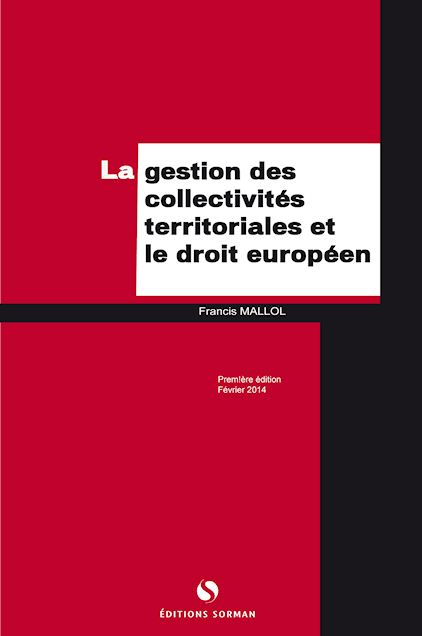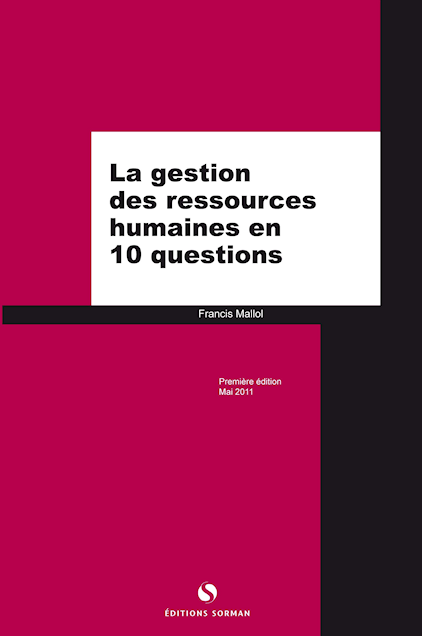Comment déterminer la durée d’un contrat de concession ? Abonnés
Dans un premier temps, c’est l’article 40 de la loi Sapin (n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques) qui a posé le principe de la limitation de la durée des conventions de délégation de service public - DSP (appelées aujourd’hui concessions). La durée se détermine en fonction des prestations demandées au délégataire et ne peut, en principe, excéder la durée normale d’amortissement des investissements à réaliser.
Puis, la loi Barnier (n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement) a complété cette disposition en précisant que, dans les domaines de l’eau potable, de l’assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, cette durée ne peut, en principe, être supérieure à vingt ans.
Enfin, dans une affaire CE, 08/04/2009, n° 271737, commune d’Olivet), le Conseil d’État rappelle que les lois Sapin et Barnier répondent à un impératif d’ordre public qui est le libre accès à la commande publique de tous les opérateurs économiques et la transparence des procédures de passation.
Le Conseil d’État estime que ces conventions de délégation de service public ne peuvent plus être régulièrement exécutées au-delà d’une date correspondant à une durée qui, calculée à compter de l’entrée en vigueur de la loi, serait supérieure à la durée maximale désormais autorisée. L'arrêt commune d’Olivet est fondé sur des motifs impérieux d’intérêt général : garantir par une remise en concurrence périodique la liberté d’accès des opérateurs économiques aux contrats de DSP et la transparence des procédures de passation.
L’acheteur public détermine la durée du contrat concession en se fondant sur plusieurs critères
L’acheteur public détermine la durée des contrats de concession en prenant en compte la nature et le montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire.
Précision : les investissements comprennent les investissements initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour l’exploitation des travaux ou des services concédés. Tel est, par exemple, le cas des travaux de renouvellement et des dépenses liées aux infrastructures, aux droits d’auteur, aux brevets, aux équipements, à la logistique, au recrutement et à la formation du personnel.
Pour les contrats de concession d’une durée supérieure à 5 ans, la durée du contrat ne peut pas excéder la durée d’amortissement des investissements.
Toutefois, dans le domaine de l’eau potable, de l’assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les contrats de concession ne peuvent avoir une durée supérieure à 20 ans.
Si l’acheteur public souhaite dépasser cette durée, il doit saisir le directeur départemental des finances publiques en joignant les justificatifs qu’il juge utile.
Sources :
- article 34, ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
- article 6, décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession.
Ludovic Vigreux le 02 novembre 2017 - n°60 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline