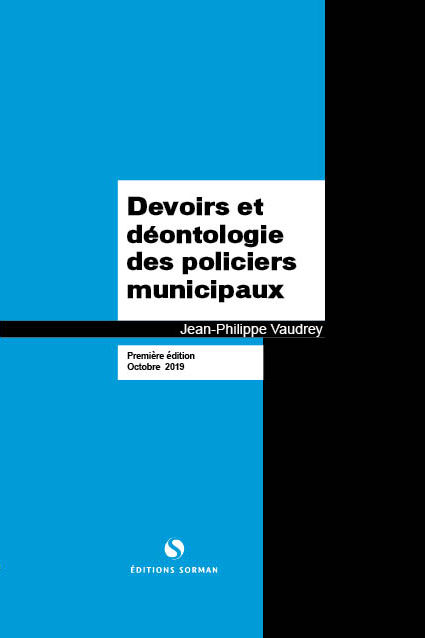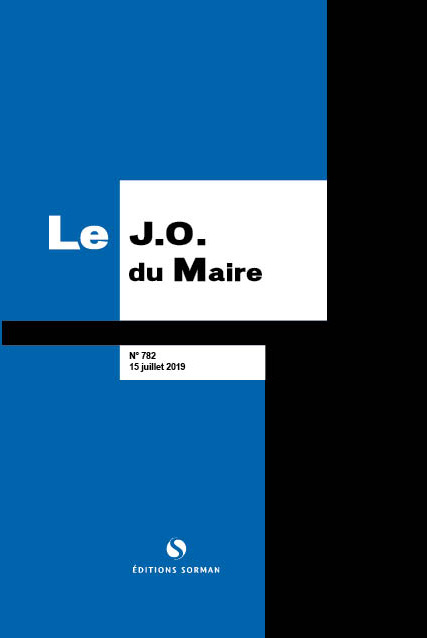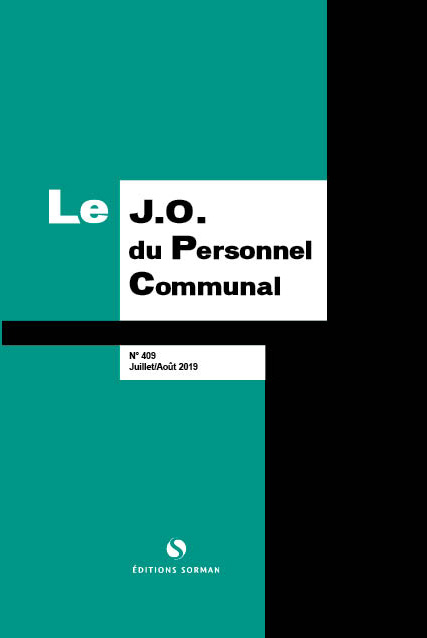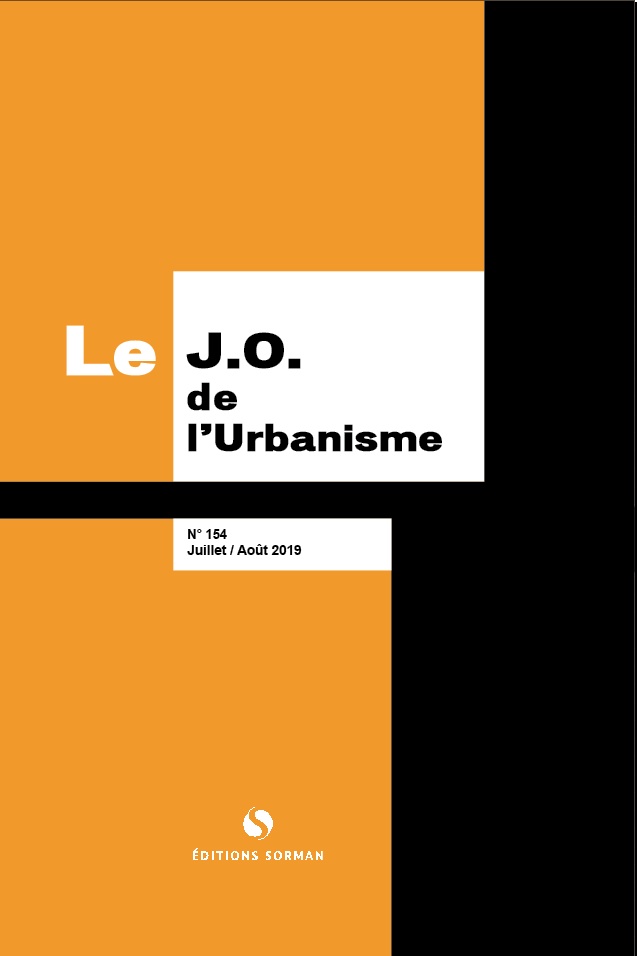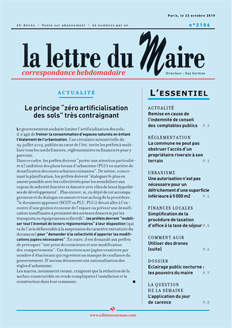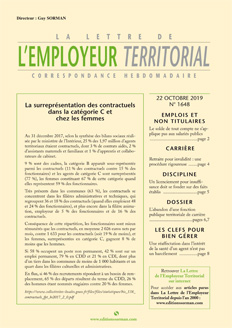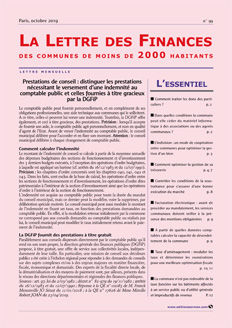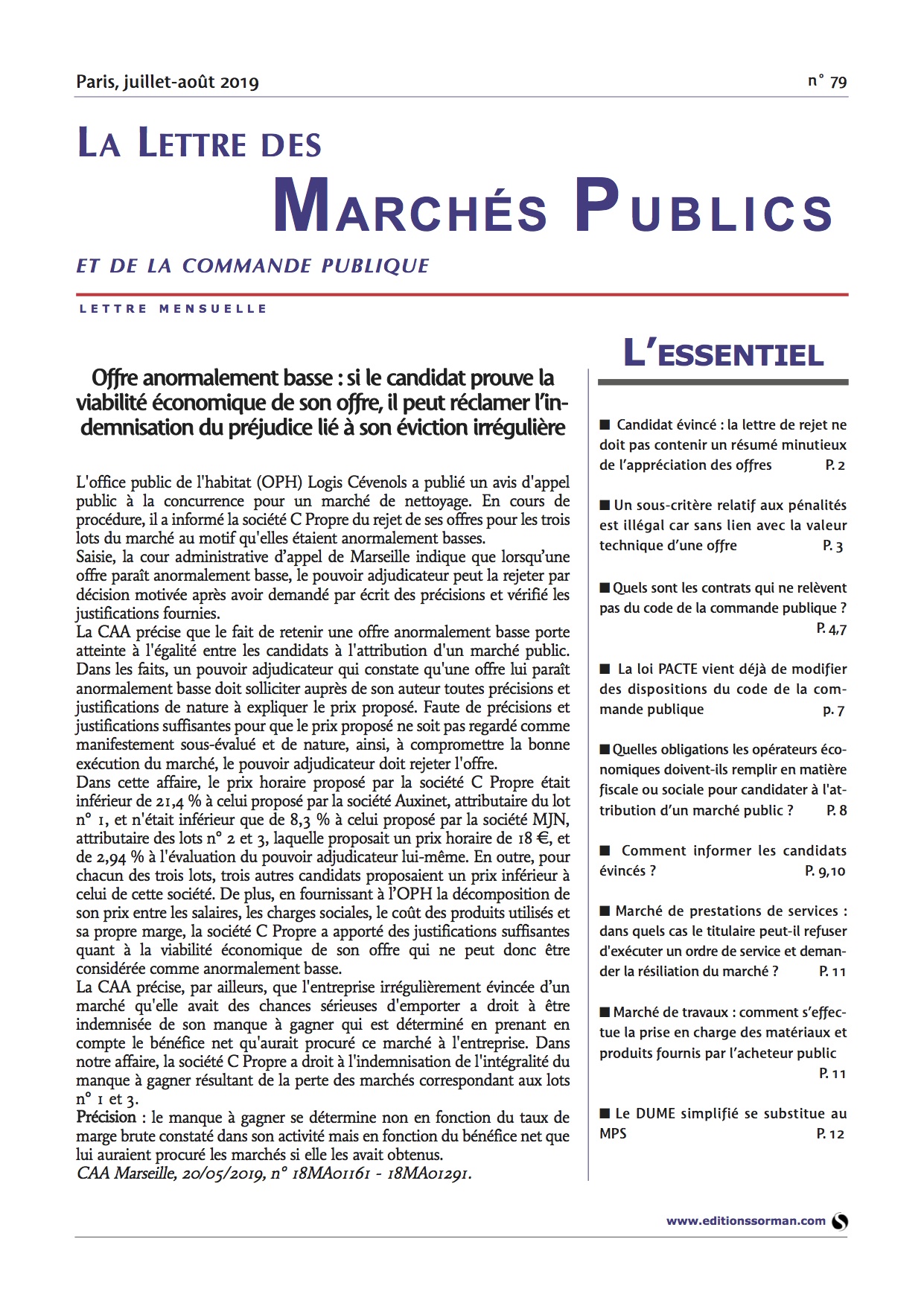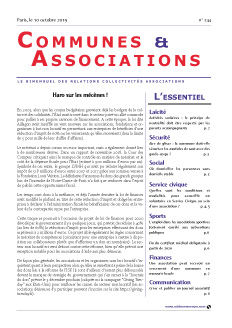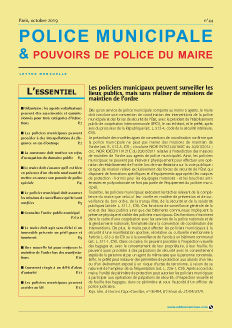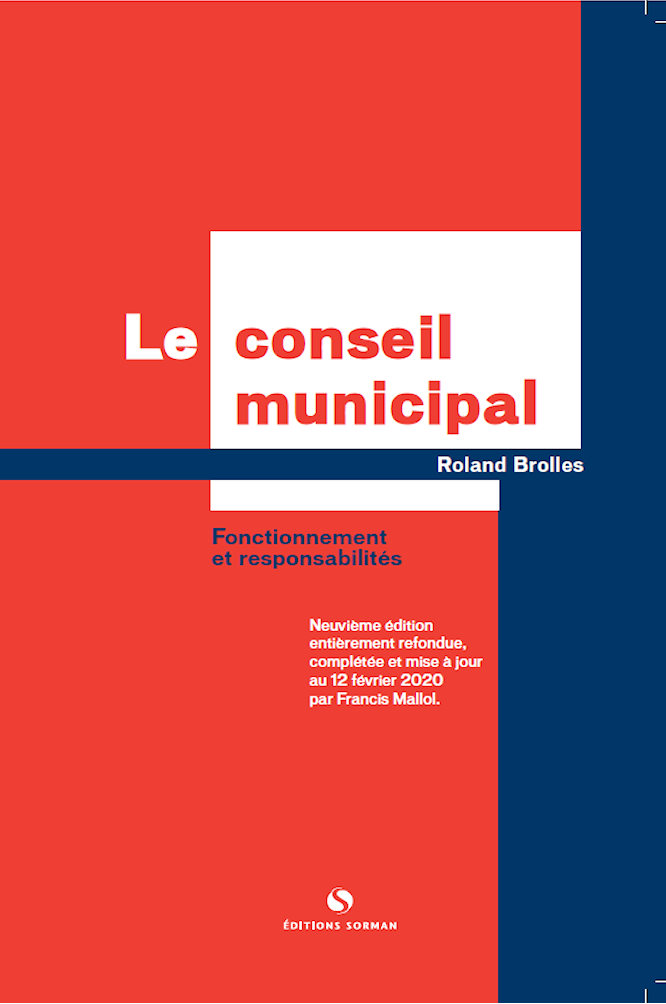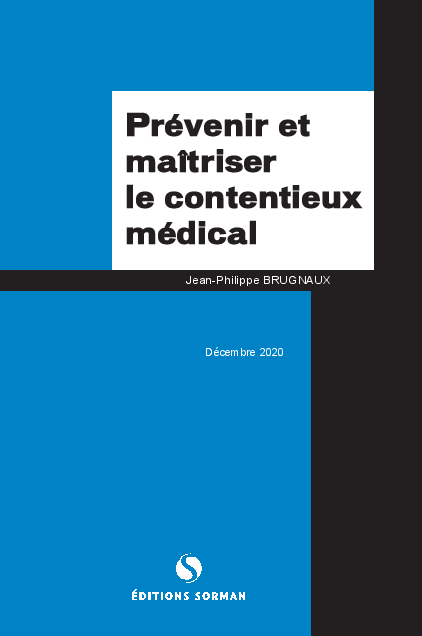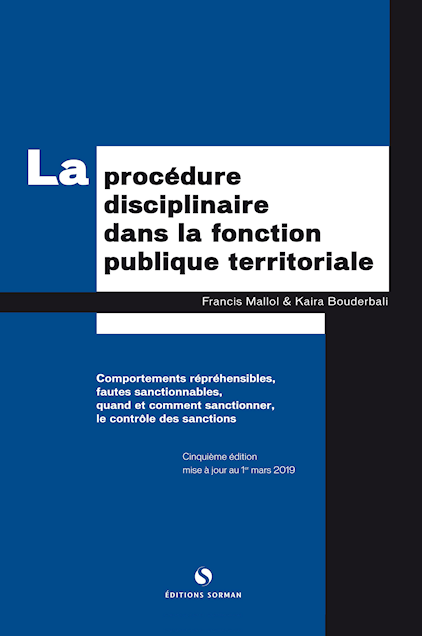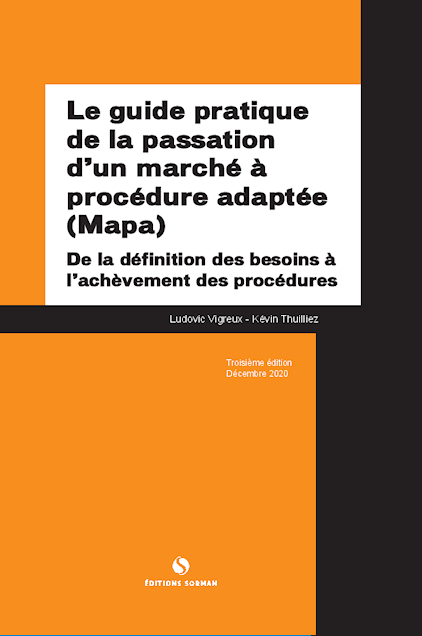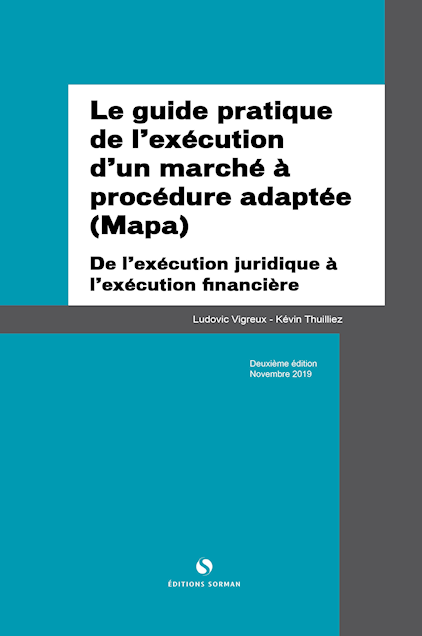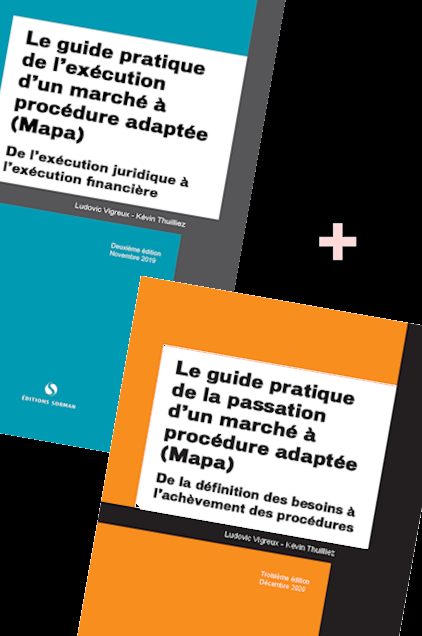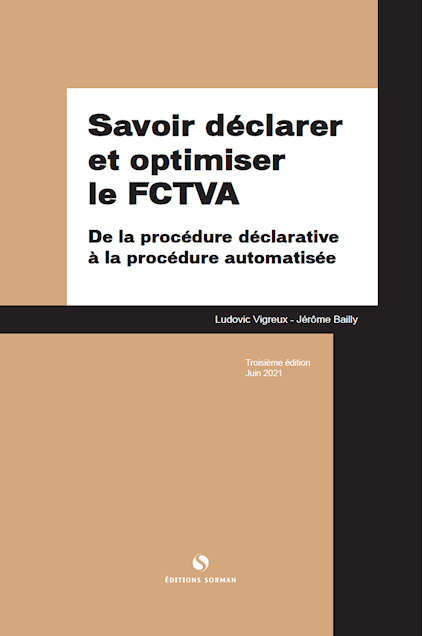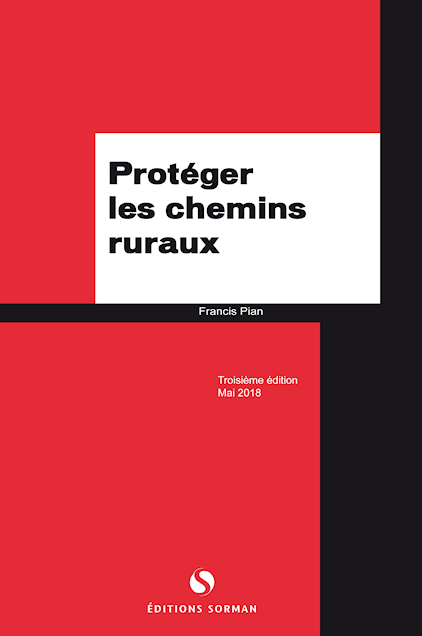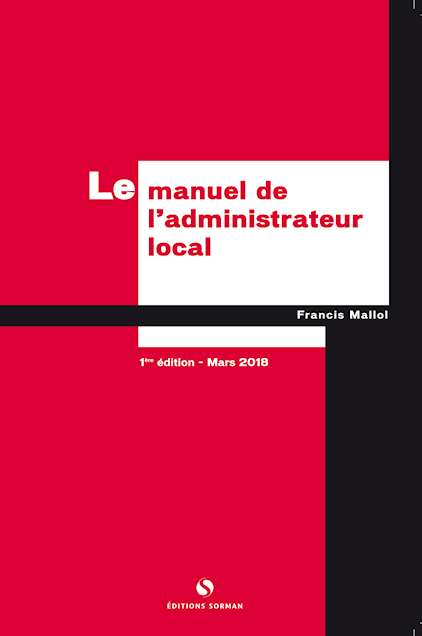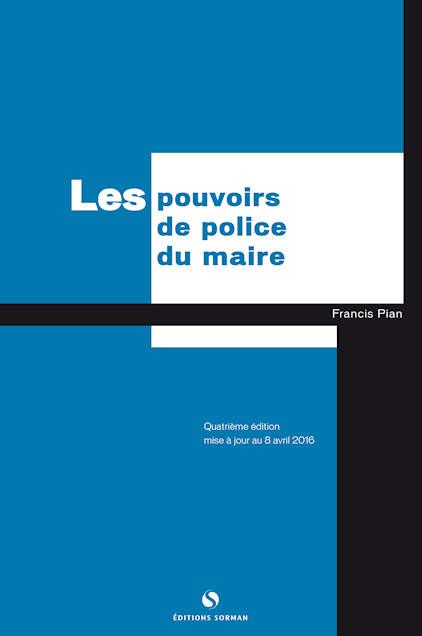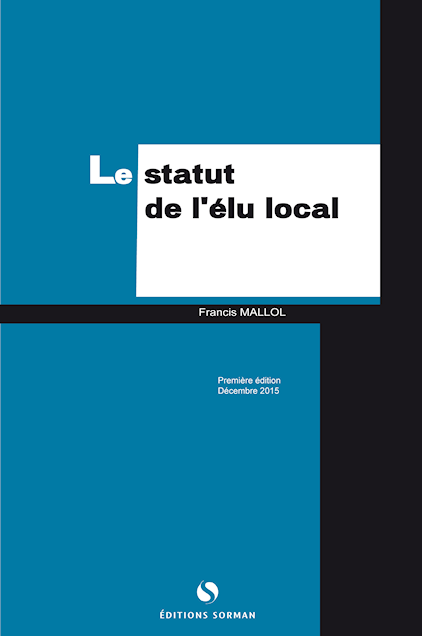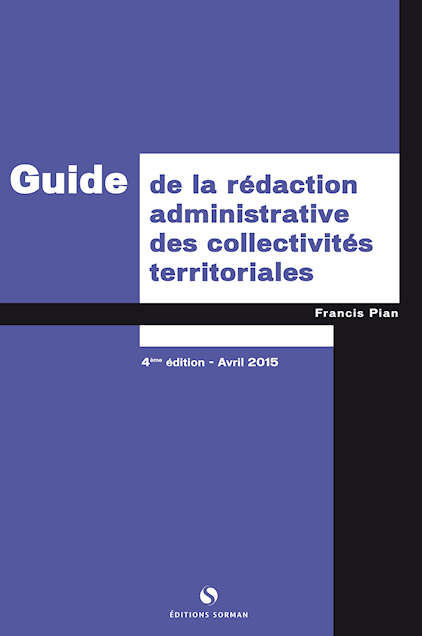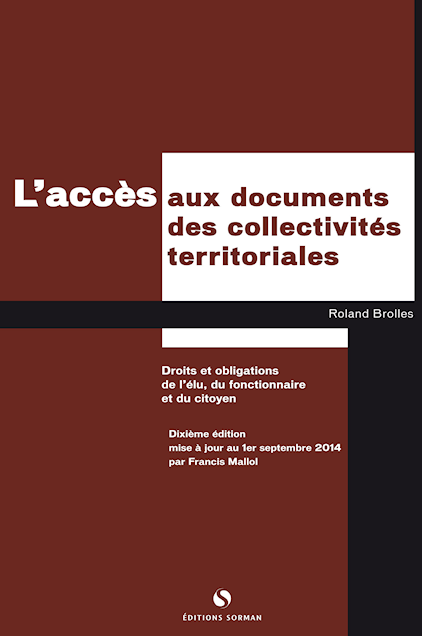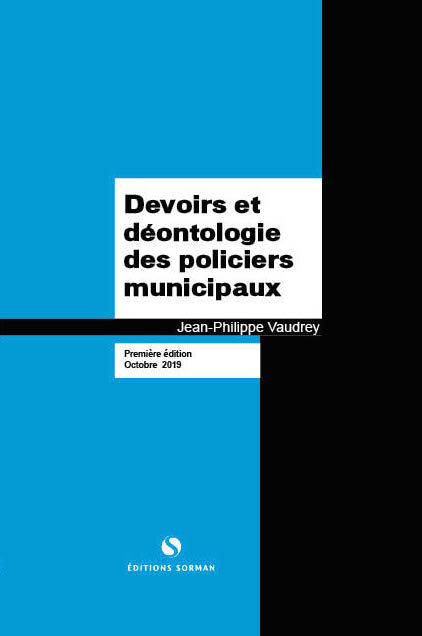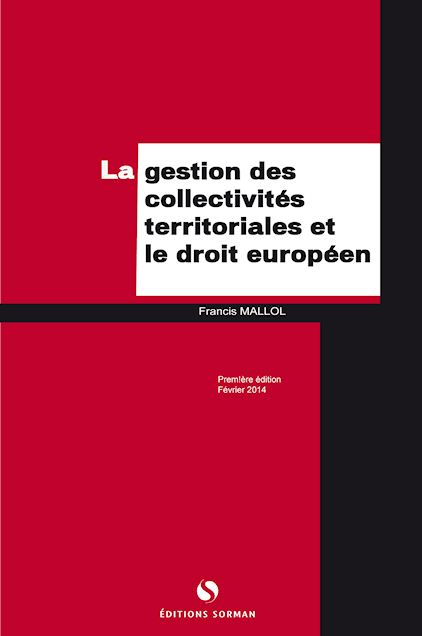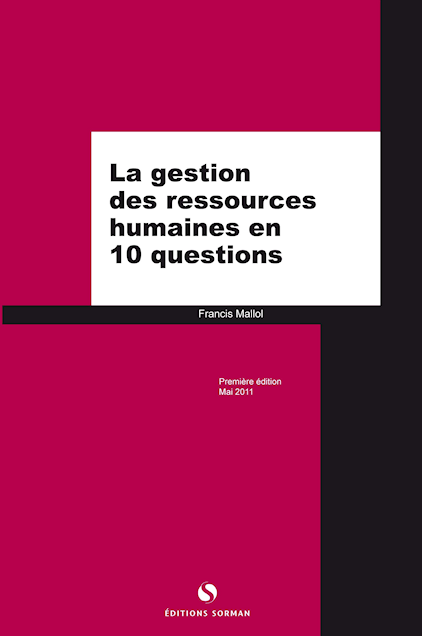Alimentation durable, économie circulaire et numérique responsable : mettre à jour ses pratiques et anticiper les échéances Abonnés
La Loi AGEC, et notamment son article 58, a créé de nouvelles obligations « vertes » pour les acheteurs publics, comme l'inclusion de clauses relatives à l’économie circulaire dans les achats depuis le 1er janvier 2021. En effet, depuis cette date, les biens acquis annuellement par les services de l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements devront être issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrer des matières recyclées. Le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 précise des éléments indispensables à la construction des politiques d’achat des collectivités : la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits.
Qu’entend-on par réemploi, réutilisation et recyclage ?
Le réemploi consiste « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus » (art. L. 541-1-1, Code de l’environnement). Par exemple : mobilier de bureau (dont certaines entreprises font de leur récupération et collecte leur cœur de métier), vêtements de seconde main, matériels informatiques d’occasion...
La réutilisation se définit comme « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau » (art. L. 541-1-1, Code de l’environnement). La réutilisation fait appel au processus défini comme « une préparation en vue de la réutilisation ; c’est-à-dire toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement. » Par exemple : téléphones reconditionnés, cartouches remanufacturées, équipements ménagers réparés, ...
Le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires souligne qu’« au-delà de ces définitions juridiques, s’agissant du réemploi ou de la réutilisation, on peut aussi évoquer les notions de marché de seconde main ou de seconde vie, de marché d’occasion, de reconditionnement ou de remanufacturage, sans exclusion d’autres vocables qui pourraient apparaître au fil des évolutions technologiques, juridiques, économiques ».
Par recyclage, on entend « toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins » (art. L. 541-1-1, Code de l’environnement). Par exemple : véhicules contenant des matériaux recyclés, matériels informatiques, bureautiques ou de reprographie comportant des matières recyclées, papier recyclé… Le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires précise que « les produits intégrant des matières recyclées sont à considérer comme tels, quelle que soit la part de matières recyclées qu’ils contiennent (à l’exception du papier recyclé que l’article 79 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte définit comme un papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées) ».
Délivrer des repas comptant 50 % de produits de qualité et durables, dont au moins 20 % de produits biologiques
Depuis le 1er janvier 2022, la Loi EGALIM impose aux collectivités de délivrer des repas comptant 50 % de produits de qualité et durables, dont au moins 20 % de produits biologiques.
Précision : le décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs précise les catégories de produits pouvant entrer dans le décompte des objectifs quantitatifs d'approvisionnement en denrées alimentaires de qualité et durables fixés pour les restaurants collectifs, ainsi que les modalités de suivi et de mise en œuvre de ces objectifs. Dans son guide pratique pour un approvisionnement durable et de qualité, le Conseil national de la restauration collective (CNRC) précise que les produits entrant le décompte d’au moins 50 % sont les suivants :
- les produits issus de l’agriculture biologique (à hauteur de 20 % minimum), y compris les produits végétaux étiquetés « en conversion » ;
- les produits bénéficiant des autres signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) ou des mentions valorisantes suivants : le Label rouge, l’appellation d’origine (AOC/AOP), l’indication géographique (IGP), la Spécialité traditionnelle garantie (STG), la mention « issu d’une exploitation à Haute Valeur Environnementale » (HVE), la mention « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la ferme », uniquement pour les produits pour lesquels existe une définition réglementaire des conditions de production ;
- les produits issus d’une exploitation bénéficiant de la certification environnementale de niveau 2 jusqu’au 31/12/2026 uniquement ;
- les produits issus de la pêche maritime bénéficiant de l’écolabel Pêche durable ;
- les produits bénéficiant du logo « Région ultrapériphérique » (RUP) ;
- les produits issus du commerce équitable ;
- les produits « équivalents » aux produits bénéficiant des signes, mentions, écolabels ou certifications mentionnés ci-avant.
Eliminer les contenants en plastique dans le cadre du portage de repas à domicile
Depuis le 1er janvier 2022, la Loi AGEC impose que les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le cadre d'un service de portage quotidien de repas à domicile soient réemployables et fassent l'objet d'une collecte.
Exclure un soumissionnaire qui n’a pas établi un plan de vigilance depuis le 4 mai 2022
La Loi Climat et Résilience permet à l'acheteur public d’exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes soumises à l'article L. 225-102-4 du code de commerce qui ne satisfont pas à l'obligation d'établir un plan de vigilance pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation (art. L. 2141-7-1, CCP).
La DAJ précise que « cette nouvelle interdiction de soumissionner, à l’appréciation de l’acheteur, renforce la prise en compte du développement durable dans la commande publique en permettant à l’acheteur d’écarter la candidature d’une entreprise qui ne respecterait pas ses obligations de transparence sur les actions menées en termes de prévention des risques sociaux et environnement dans le cadre de son activité ». Toutefois, il s’agit d’une interdiction de soumissionner facultative que l’acheteur public doit introduire dans son règlement de la consultation.
Il revient à l’acheteur public de vérifier la nature de la justification de l’exclusion ; lors de cet examen, il doit réunir un ensemble de preuves suffisantes.
Attention : avant de prononcer l’exclusion, l’acheteur public doit mener une procédure contradictoire. La DAJ précise que l’acheteur public ne peut prononcer l’exclusion que si les éléments apportés par cet opérateur ne permettent pas d’établir que l’exclusion est bien justifiée et proportionnée à la gravité des faits. En effet, « l'acheteur public qui envisage d'exclure un opérateur économique (…) doit le mettre à même de présenter ses observations afin d'établir dans un délai raisonnable et par tout moyen qu'il a pris les mesures nécessaires pour corriger les manquements précédemment énoncés et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement » (art. L. 2141-11, CCP).
Intégrer l’indice de réparabilité parmi les critères de sélection pour les achats numériques
Depuis le 1er janvier 2023, lors de l'achat public de produits numériques disposant d'un indice de réparabilité, la Loi REEN contraint les acheteurs publics à prendre en compte l'indice de réparabilité. Rappelons que, depuis le 1er janvier 2021, les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d'équipements électriques et électroniques doivent communiquer aux vendeurs de leurs produits ainsi qu'à toute personne qui en fait la demande l'indice de réparabilité de ces équipements ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir.
Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné. De même, les vendeurs d'équipements électriques et électroniques doivent informer le consommateur, au moment de l'acte d'achat, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié de l'indice de réparabilité de ces équipements (art. L. 541-9-2, Code de l’environnement).
Délivrer des repas comptant 60 % de produits de qualité et durables pour les viandes et les poissons à compter du 1er janvier 2024
La loi Climat et résilience a renforcé les dispositions de la Loi EGALIM en portant à 60 % le taux de produits de qualité et durables pour les viandes et les poissons au 1er janvier 2024. Le taux 60 % se calcule en valeur d’achats hors taxe de produits alimentaires par année civile, sur l’ensemble des repas, boissons et collations comprises, rapportée à la valeur d’achats hors taxe de l’ensemble des achats de produits alimentaires entrant dans la composition des repas.
Remplacer les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique à compter du 1er janvier 2025
A compter du 1er janvier 2025, la loi EGALIM prévoit la fin de l'utilisation des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique, au profit de l’utilisation de matériaux inertes et durable dans la restauration collective. Attention : cette mesure n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2028 pour les communes de moins de 2 000 habitants.
Elaborer un programme de travail basé sur un état des lieux en matière de politique numérique responsable au plus tard le 1er janvier 2025 (communes et EPCI de plus de 50 000 habitants)
Au plus tard le 1er janvier 2025, les communes et EPCI de plus de 50 000 habitants devront définir une stratégie numérique responsable. La Loi REEN impose de fixer des objectifs de réduction de l'empreinte environnementale du numérique et de déterminer un plan d’actions pour les atteindre. Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, l’acheteur public doit élaborer un programme de travail préalable à l'élaboration de son plan stratégique. Dans ce cadre, il devra établir un état des lieux recensant les acteurs concernés et rappelant, le cas échéant, les mesures menées pour réduire l'empreinte environnementale du numérique.
La stratégie numérique responsable comprend les objectifs de réduction de l'empreinte numérique du territoire concerné, les indicateurs de suivi associés à ces objectifs et les mesures mises en place pour y parvenir. Elle détermine les moyens d'y satisfaire. Ces objectifs et les mesures mises en œuvre peuvent avoir un caractère annuel ou pluriannuel. Les objectifs de la stratégie peuvent notamment porter sur la commande publique locale et durable, dans une démarche de réemploi, de réparation et de lutte contre l'obsolescence (art. D. 2311-15-1, CGCT).
Notons que les objectifs annuels de réemplois et de réutilisation des équipements informatiques réformés sont de 25 % pour 2023, 35 % pour 2024 et de 50 % à partir de 2025).
Source : art. 16, Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France ; Décret n° 2023-266 du 12 avril 2023 fixant les objectifs et modalités de réemploi et de réutilisation des matériels informatiques réformés par l'Etat et les collectivités territoriale.
Prendre en compte l’indice de durabilité par les critères de sélection des offres à compter du 1er janvier 2026
A compter du 1er janvier 2026, lors de l'achat public de produits numériques disposant d'un indice de durabilité, la Loi REEN prévoit la prise en compte de l’indice de durabilité parmi les critères de sélection des offres.
Précision : à compter du 1er janvier 2024, les producteurs ou importateurs de certains produits devront communiquer aux vendeurs et à toute personne qui le demande l'indice de durabilité de ces produits et les paramètres ayant permis de l'établir. Cet indice inclut notamment de nouveaux critères telles la fiabilité et la robustesse du produit et complète ou remplace l'indice de réparabilité lorsqu'il existe. Les vendeurs des produits concernés ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent, sans frais, le consommateur, au moment de l'achat du bien, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié de l'indice de durabilité de ces produits. Le vendeur met également à disposition du consommateur les paramètres ayant permis d'établir l'indice de durabilité du produit.
Mettre fin à l’usage de l’unique critère « prix » au plus tard en août 2026
Afin de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur public devra tenir compte d’au moins un critère relatif aux caractéristiques environnementales de l'offre. Ces dispositions entreront en vigueur au plus tard en août 2026. Dans son commentaire, la DAJ précise que « le législateur a choisi de ne pas énumérer les caractéristiques environnementales qui doivent être spécifiquement prises en compte en tant que critère. En effet, la formulation retenue (…) demeure large afin de laisser une certaine souplesse aux acheteurs ».
Attention : cette nouvelle rédaction du CCP signifie que l’acheteur public ne peut plus retenir le critère prix comme critère unique. S'il envisage de retenir un seul critère, il ne pourra retenir que le coût déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie.
Sources : * Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, et pour une alimentation saine, durable et accessible à tous ; ** Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ; *** Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; **** Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France ; DAJ.
Olivier Mathieu le 10 octobre 2023 - n°125 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline