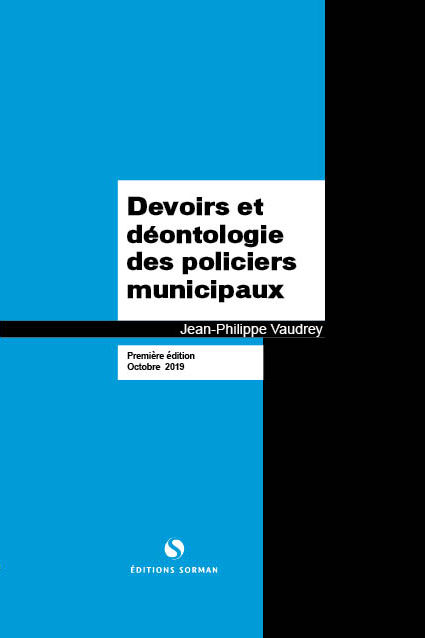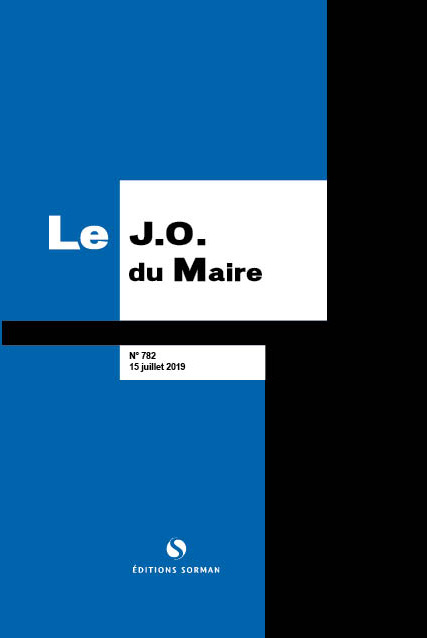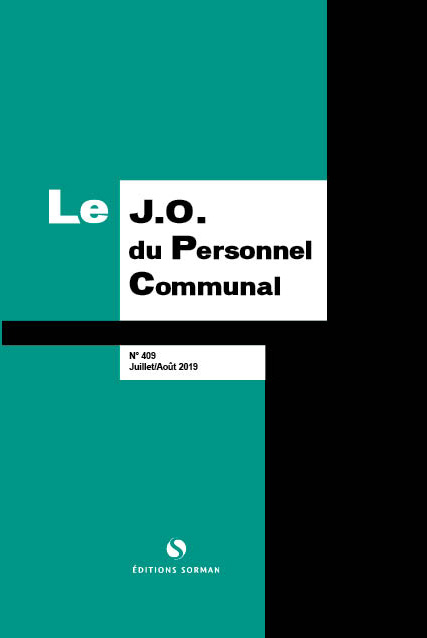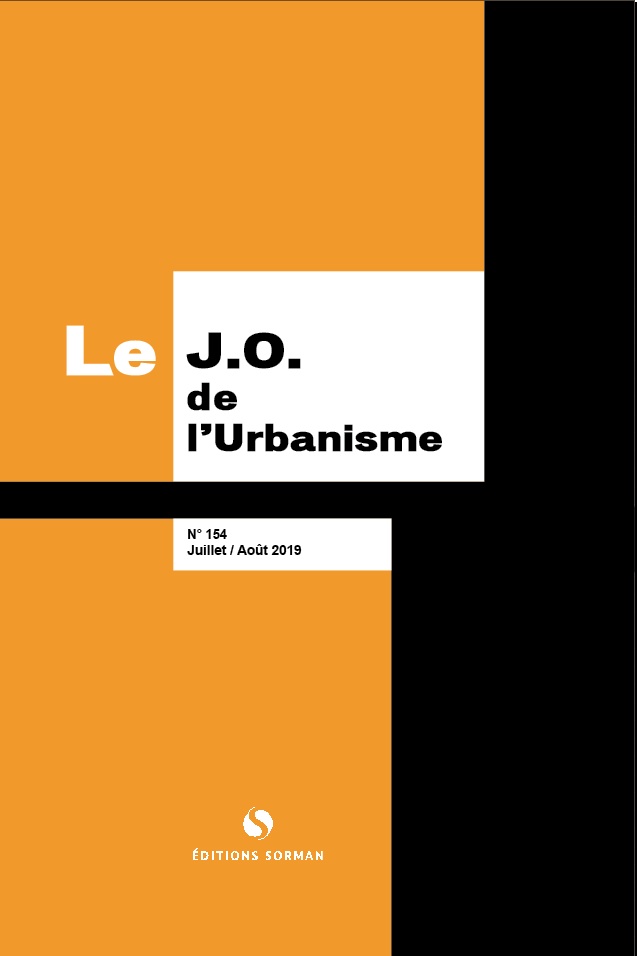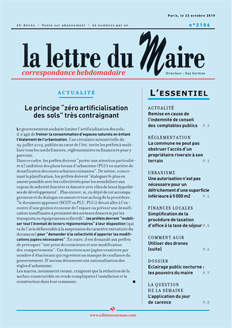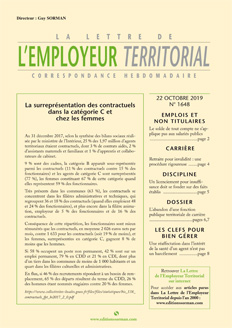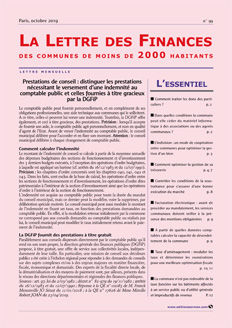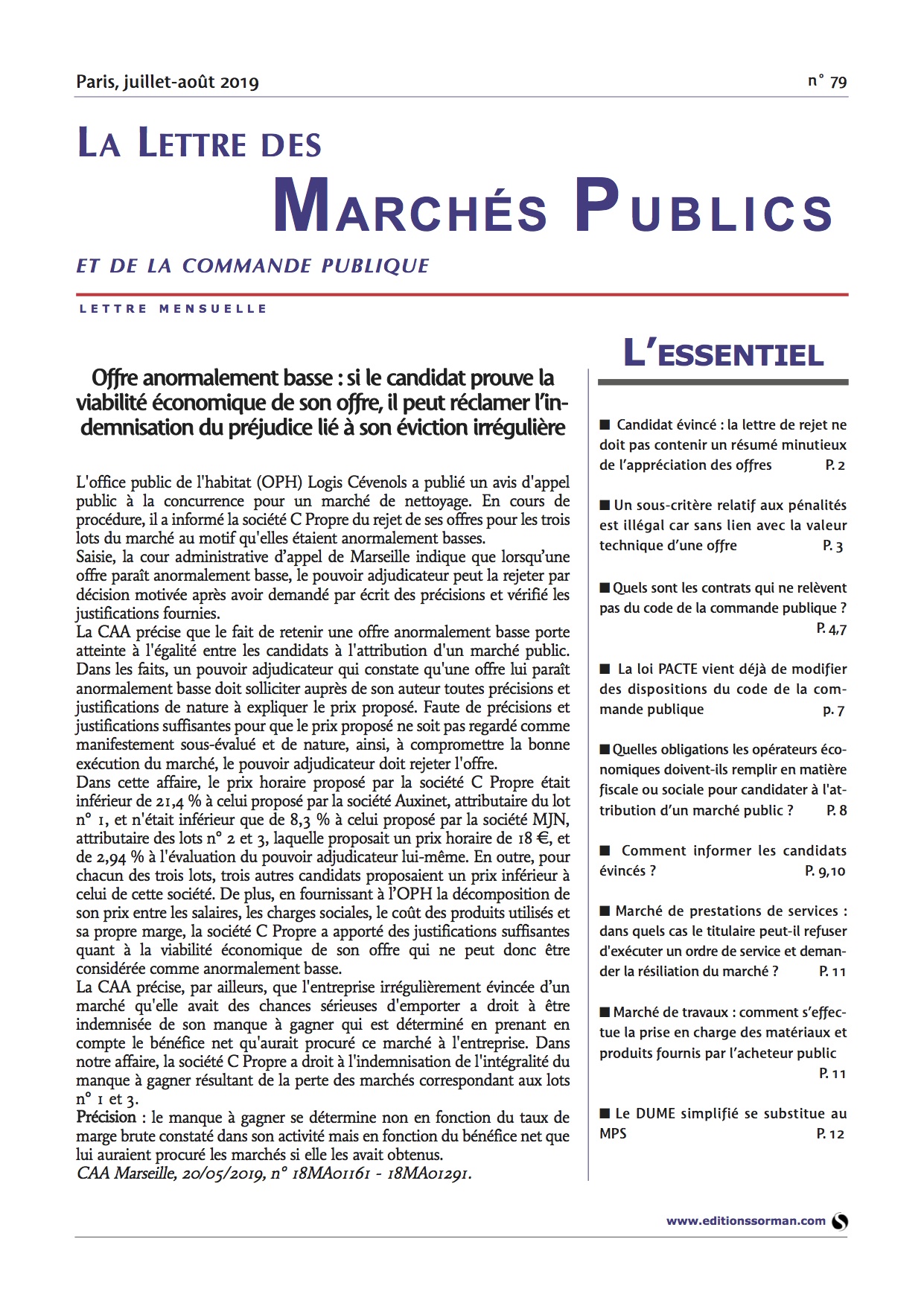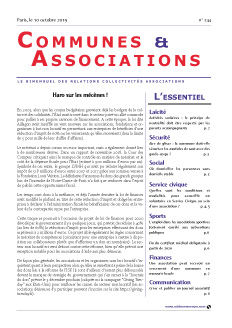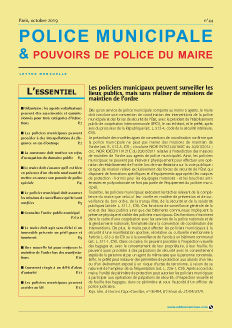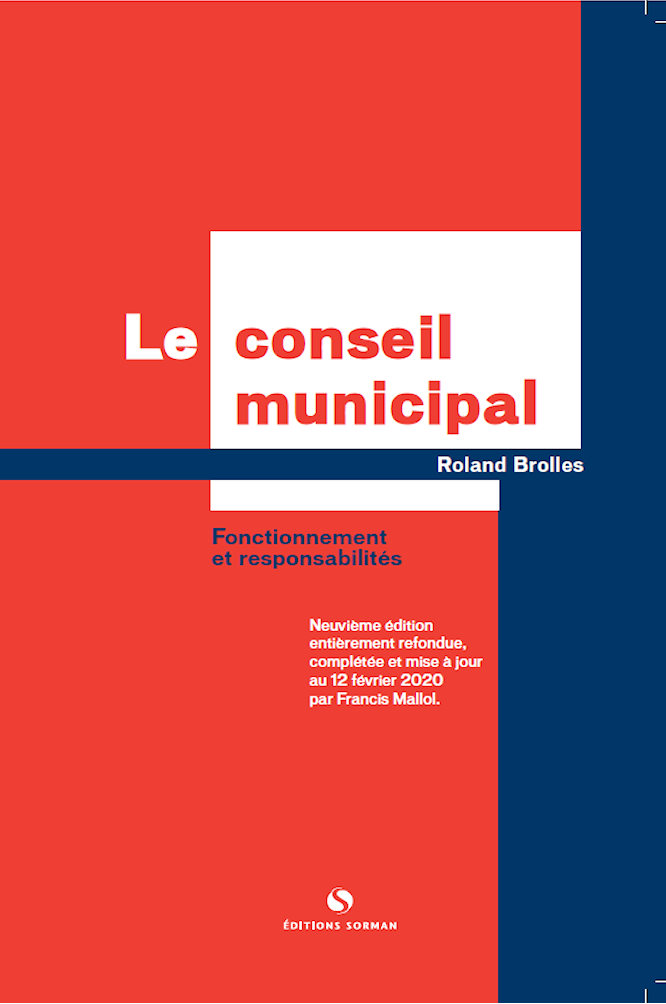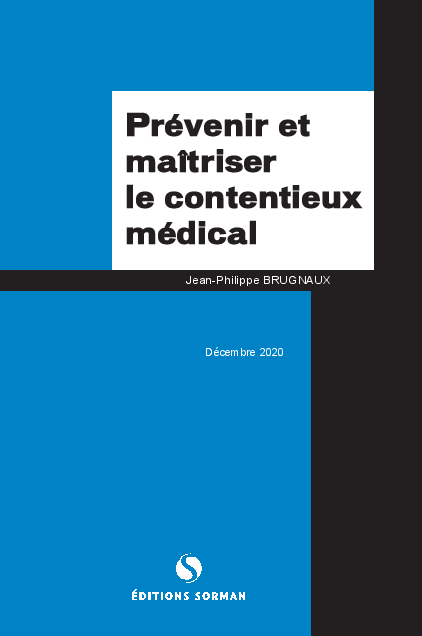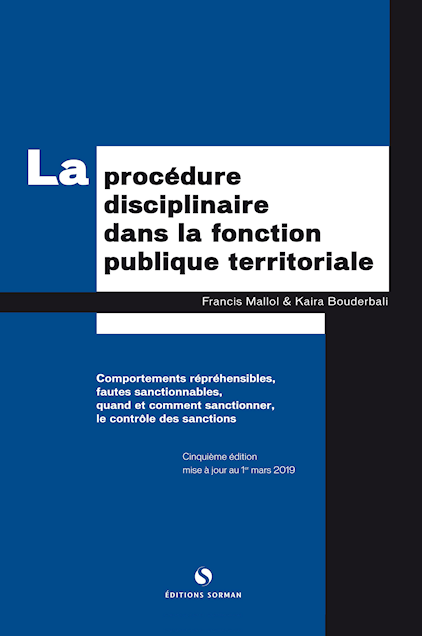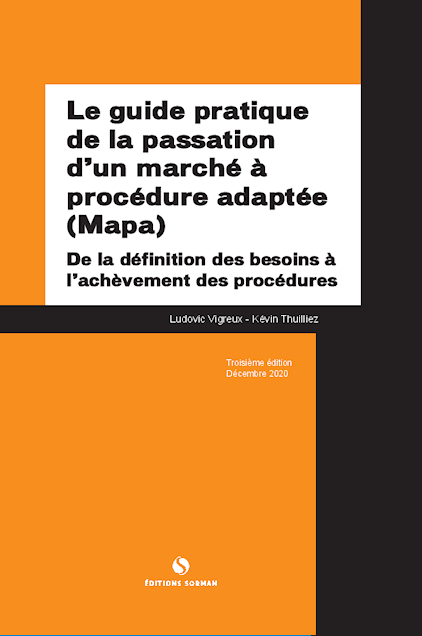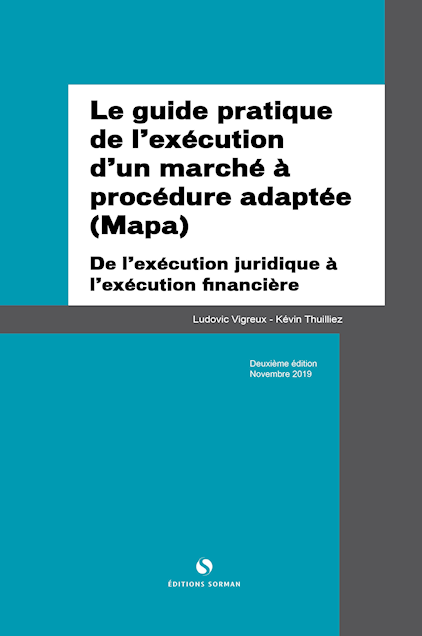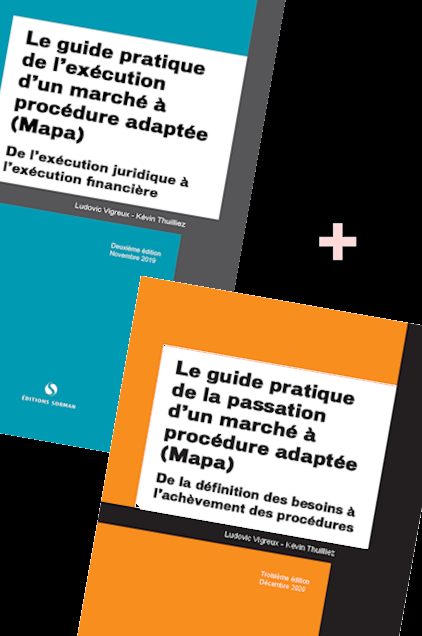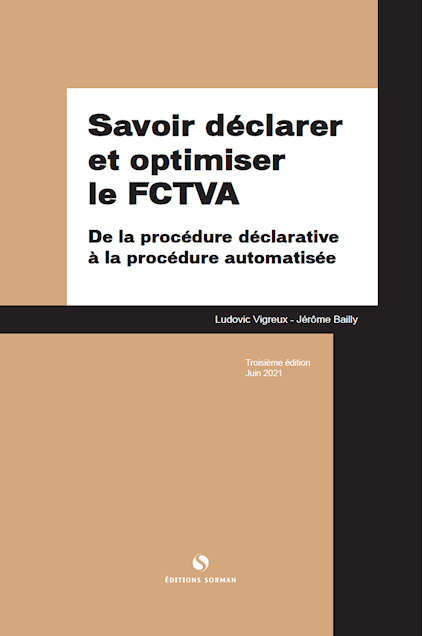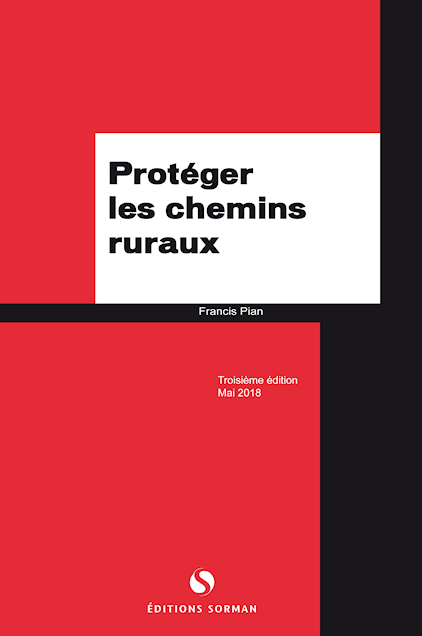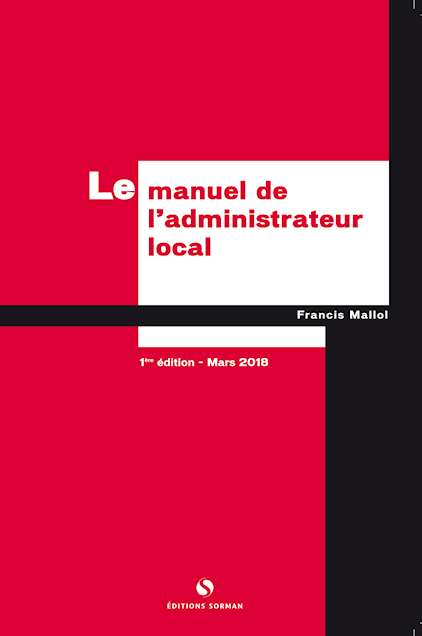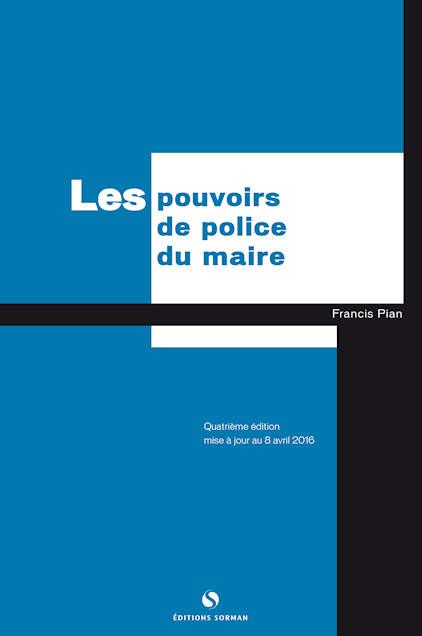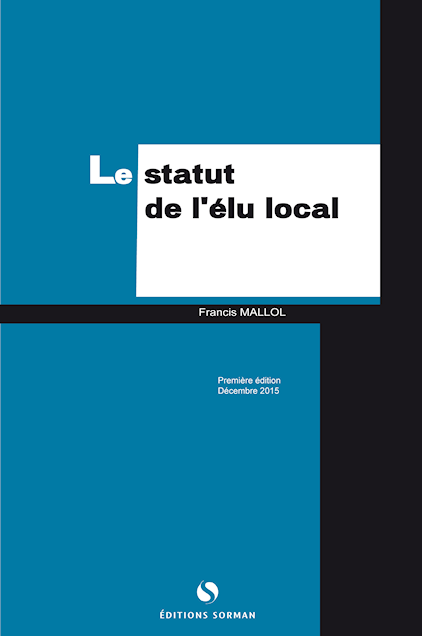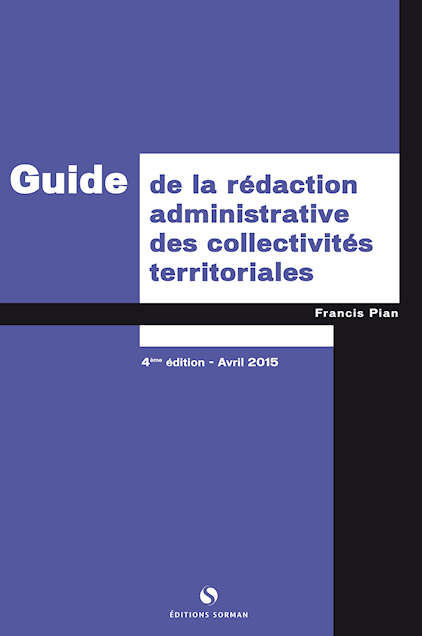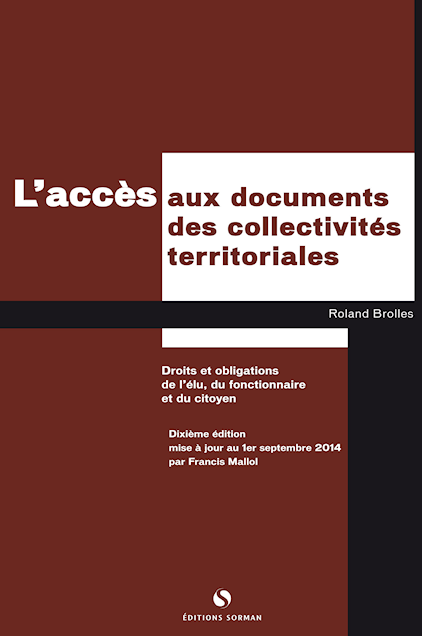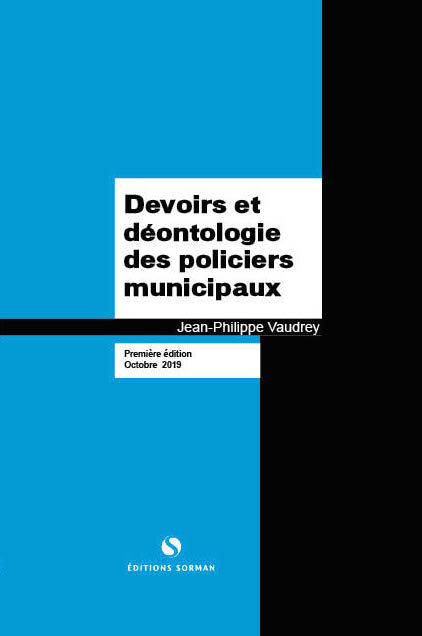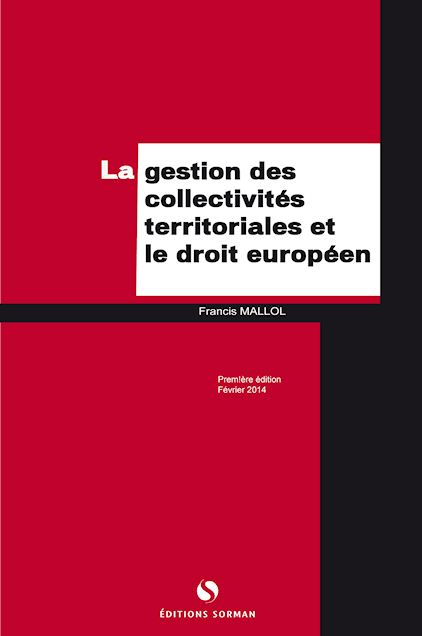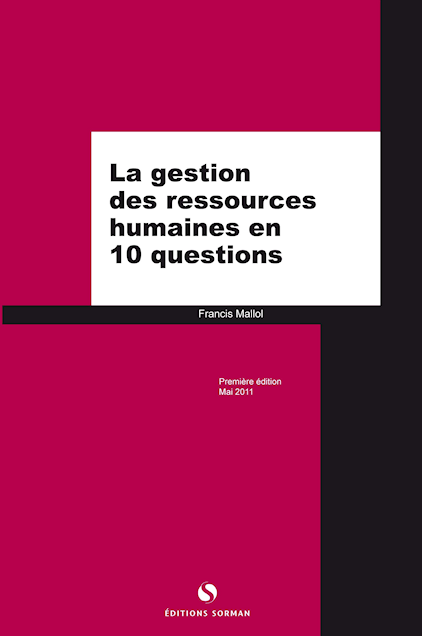L’acheteur public peut recourir à la transaction dans deux cas Abonnés
« La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître » (art.2044 et suivants, code civil).
Le protocole transactionnel est l’acte qui permet d’indemniser le cocontractant de l’acheteur public lorsque le paiement des prestations exécutées par celui-ci ne se rattache à aucun support contractuel valide ; c’est, par exemple, le cas de prestations commandées à un prestataire en dehors de tout contrat ou en dehors des prescriptions d’un contrat existant, c’est-à-dire en dépassement des quantités ou du montant prévu, ou au-delà de la durée du marché.
L’acheteur public peut également recourir au protocole transactionnel lorsqu’un contrat a été annulé par le juge administratif ; en effet, la collectivité dont le contrat a été annulé doit verser une indemnité à l’entreprise.
Les deux cas dans lesquels l’acheteur public peut recourir au protocole transactionnel
Les acheteurs publics peuvent recourir au protocole transactionnel dans 2 cas :
- la résolution des difficultés d'exécution des contrats ;
- l’indemnisation des parties en l’absence de contrat valide.
1 - La résolution des difficultés d'exécution des contrats
L’acheteur public peut recourir au protocole transactionnel dans le but de mettre fin à un contrat pour régler la situation juridique délicate née de l’annulation des actes préparatoires du contrat, sans que le contrat n’ait été lui-même annulé (CE, 29/12/2000, Comparat).
2 – L’indemnisation des parties en l’absence de contrat valide
Dans le cas où la collectivité n’a signé aucun contrat, le protocole transactionnel constitue un titre juridique permettant le paiement des prestations effectuées. La transaction peut également aboutir à l’indemnisation de l’une des parties en cas de nullité du contrat.
Dans certaines circonstances, la collectivité fait exécuter des travaux, fournitures ou services à un prestataire en dehors de tout contrat ou encore en dehors des prescriptions d’un contrat existant (dépassement des quantités ou du montant prévu, ou au-delà de la durée du marché).
Attention : l’acheteur public ne peut recourir ni à un marché de régularisation pour couvrir ces irrégularités (CE, 27/05/1998, commune d’Agde), ni à un marché complémentaire ou à un avenant si les prestations ont déjà été exécutées.
Lorsque le contrat est nul, la collectivité ne peut réparer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les dommages subis par son cocontractant dans l’exécution de ses engagements. Elle ne peut pas procéder au versement de sommes dues. La nullité du contrat fait également obstacle à la réparation, sur le terrain contractuel, des préjudices subis par l’administration du fait de la mauvaise exécution par le cocontractant de ses obligations. Elle s’oppose à la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs (CE Sect., 29/01/1982, Martin) ou à l’invocation de fondements de responsabilité dérivés de l’exécution des contrats, telle la garantie de bon fonctionnement. Les collectivités peuvent rechercher la responsabilité quasi-contractuelle ou quasi-délictuelle de leurs cocontractants (CE, 22 février 2008, Schmeltz et Orselli).
Sources : art.2044 et suivants, code civil ; circulaire du 7/09/2009 relative au recours à la transaction pour la prévention et le règlement des litiges portant sur l'exécution des contrats de la commande publique - NOR : ECEM0917498C - Instruction n° 10-009-M0 du 12 avril 2010.
Ludovic Vigreux le 02 octobre 2017 - n°59 de La Lettre des Marchés Publics et de la commande publique
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline